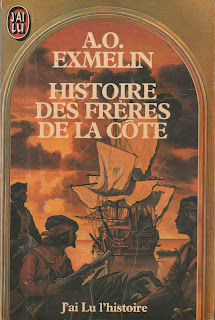L’épopée des femmes pirates : les filles du vent
Documentaire historique
France, 2024
90 minutes
Réalisation : Laurence Thiriat et Frédéric Malègue
Scénario : Éric Menu et Laurence Thiriat
Production : Goyaves, Amour Fou Luxembourg et Film Fund Luxembourg pour NDR, en collaboration avec l'ORF, France TV et Arte.
Première diffusion (en streaming) : Arte, 13 janvier 2025.
https://www.goyaves.com/les-femmes-pirates/
Un an déjà presque sans un seul petit billet de blogue! Ce n'est pas faute de matière, car j'ai plusieurs textes en chantier, mais bien faute de temps pour les compléter. Il faut dire aussi que le monde d'après la grippe chinoise me pèse, moralement, et depuis la dernière année, financièrement, sans compter les petits soucis qui s'accumulant les uns sur les autres finissent aussi par peser, mais c'est la vie. Il y a des hauts et des bas. Et puis quand on se compare avec pire que soi, on finit par se dire : je suis privilégié tout compte fait. N'est-ce pas?
N'empêche, s'il n'y avait pas eu toutes ces DEI et autres stupidités du genre telle l'écriture inclusive, digne du calendrier révolutionnaire, avec un écoeurant parfum d'ère soviétique. Que dire encore de la sempiternelle crise climatique qu'on nous agite tel un nouvel Apocalypse, et qui sert de prétexte aux investissements les plus fous et les plus inconséquents, et à des taxes nouvelles et inédites. Il y a eu aussi, et non des moindres, ces milliards dépensés durant la fameuse pandémie, et cette immigration volontairement exagérée (du moins ici) qui ont contribué beaucoup à l'inflation. Ce qui fait que ceux qui comme moi appartiennent à la classe dite moyenne s'appauvrissent de jour en jour, et que dire de ceux qui sont plus pauvres... Nos politiciens auraient avantage à faire appel à leur sens commun, et moins à l'intelligence artificielle.
C'est triste à dire, mais la seconde élection de Trump comme président des États-Unis est peut-être ce qu'il fallait pour secouer nos sociétés qui se sont engoncés dans un carcan quasi-religieux depuis le début du second millénaire. Espérons toutefois que le remède ne soit pas pire que le mal... mais aux grands maux, les grands remèdes, paraît-il...
Donc, je suis d'humeur méchante... De quoi voulais-je vous parler? Ah oui! Ce documentaire que j'ai visionné sur les femmes pirates. Je ne serai pas très gentil là non plus. Avant de commencer, je dois d'abord faire ce qu'il est convenu d'appeler dans le jargon « une déclaration d'intérêts ». Il y a presque deux ans, j'ai été approché par l'un des scénaristes du documentaire pour y participer à titre d'expert, sur recommandation de quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai cependant refusé pour plusieurs raisons qui me sont personnelles, mais que je peux résumer ainsi : la caméra et le micro ne sont pas ma tasse de thé. Bref, je suis meilleur à l'écrit. Je ne voulais donc pas faire dépenser inutilement temps et argent à ces gens-là pour une entrevue qui risquait d'être ratée. À chacun ses petits caprices. Une autre raison qui a motivé, accessoirement, mon refus, était le sujet du documentaire. Il me mettait mal à l'aise. Par mes recherches, je sais que pour toute la période que j'ai étudiée, il n'y a aucune femme pirate ou « flibustière » dans les Antilles, hormis deux des vedettes du documentaire, Mary Read et Anne Bonny, membres de l'équipage d'un petit pirate (John Rackham) qui serait demeuré insignifiant sans la curiosité que suscita la présence de ces deux femmes à ses côtés. Ce qui m'étonna encore plus, et me confirma dans mon malaise, c'est qu'outre ces deux piratesses avérées, le documentaire devait également aborder — et ce fut d'ailleurs le cas — la carrière « flibustière » de Marie Dieulveult, seconde épouse de Laurent de Graffe, l'un des plus fameux marins de la mer des Antilles de la seconde partie du XVIIe siècle.
Quelques mots ici concernant De Graffe. D'origine hollandaise, il s'était d'abord établi à Tenerife, aux Canaries, où il était marié. En 1676, lors de la prise du navire espagnol à bord duquel il servait comme maître-canonnier, il avait été fait prisonnier par des flibustiers de Saint-Domingue. Ses qualités étaient telles que, tout prisonnier qu'il fût alors, le sieur de Grammont, l'un des deux capitaines qui l'avaient capturé, lui avait donné le commandement du fort défendant l'entrée du lac de Maracaïbo lors de la campagne de six mois que les flibustiers français y firent en 1678. Au retour de cette expédition, le même Grammont l'avait promu capitaine d'un petit bâtiment. Devenu chef flibustier, De Graffe s'était signalé par la prise (1682) d'un navire de guerre espagnole portant 120 000 écus destinés aux garnisons et fortifications de Santo Domingo et de San Juan de Puerto Rico. Il devint ensuite l'un des plus importants capitaines corsaires des Antilles, participant entre autres aux prises de Veracruz (1683) et de Campêche (1685). Nommé major pour le roi (1686) à Saint-Domingue, il fut promu lieutenant de roi (1691) dans la même colonie. Après que son épouse canarienne eut fait annuler leur union, De Graffe s'était remarié, en 1693, avec Marie Dieuleveult, veuve possédant des terres au Cap et au Quartier-Morin (côte nord de Saint-Domingue), héritées de ses deux précédents époux.
Voici ce que j'écrivais au sujet de cette seconde madame de Graffe à la personne de chez Goyaves (la société productrice du futur documentaire) avec qui j'ai échangé quelques courriels concernant ma possible participation au projet. C'était en avril 2023 :
« ...cette histoire voulant que Laurent de Graffe ait amené son épouse en course avec lui ne repose que sur du vent. Au mieux, la dame a-t-elle pu voyager à bord d'un navire commandé par son mari, ou appartenant à celui-ci (quelque part entre la date de leur mariage en 1693 et sa capture par les Espagnols en 1695) pour passer d'un quartier de Saint-Domingue à l'autre, ce qui est, par ailleurs, invérifiable.
« Pour savoir d'où provenait cette fable, j'ai vérifié autant dans les manuscrits du Jésuite Jean-Baptiste Le Pers (réputé pour ses nombreuses erreurs) que dans l'Histoire de Saint-Domingue, de son confrère Charlevoix, mais je n'y ai absolument rien trouvé. Nul besoin de vous dire qu'il n'y a rien à ce sujet dans les archives non plus.
« En fait, la référence la plus ancienne à cette fable se trouve dans Léon Treich, Les Gentilshommes de la flibuste (1944) :
...elle suivit Laurent De Graff dans tous ses embarquements... demeurant sur le pont des bateaux au milieu des plus rudes canonnades. Les flibustiers la considéraient comme une sorte de mascotte... et il lui était toujours attribué une part de butin.
« C'est ainsi que Francis Lacassin cite Treich dans sa préface à une édition moderne et tronquée du livre d'Exquemelin (Éditions J'ai Lu, 1984). Voilà, c'est encore un exemple, parmi bien d'autres, malheureusement, démontrant qu'il ne faut pas se fier à ce qui a été écrit sur les flibustiers avant la fin du siècle dernier. J'avoue m'y être laissé prendre il y a plusieurs années, et je comprends maintenant pourquoi mon défunt collègue Jacques Gasser, dans son dictionnaire des flibustiers, ne mentionnait pas que De Graffe amenait son épouse avec lui en course. Bref, tout ça est à mettre au panthéon des arnaques aux côtés du capitaine Borgnefesse, de T'Sterstevens et Alaux. »
Que Marie Dieuleveult ait eu un fort caractère et beaucoup de tempérament, je le concède volontiers, mais de là à en faire une « flibustière », il y a un monde, qu'on a ici franchi allègrement au mépris non seulement de toute véracité historique, mais de toute vraisemblance!
Il est un peu dommage, par ailleurs, que le documentaire ait brossé un portrait si stéréotypé de Laurent de Graffe, personnalité beaucoup plus complexe que ce qui en est dit, qui songea plusieurs fois à quitter les Français au cours de sa carrière, soit pour joindre les Anglais, ou pour retourner servir les Espagnols, ayant eu des offres à cet effet de ces deux nations. Ce fut d'ailleurs le cas au moment où sa femme fut capturée au Cap en 1695. Enfin, il n'était pas le sujet du documentaire (bien qu'il en mérite un à lui tout seul), mais seulement l'un de ses « accessoires masculins ».
Beaucoup plus intéressant aurait été de révéler le rôle que certaines femmes jouèrent en arrière-plan dans l'univers masculin de la flibuste et de la piraterie. Par exemple, le cas de Marthe Baudry, l'épouse de Jean-Baptiste Ducasse, ancien négrier et corsaire, gouverneur de Saint-Domingue (1691-1700) contemporain et supérieur du sieur de Graffe. Depuis Dieppe, elle fut la procuratrice de son mari en France, et de bien d'autres, et on peut la qualifier de véritable « femme d'affaires » de son temp, à l'exemple de sa mère Marthe Chauvel, elle-même fille et veuve d'armateurs, et elles ne sont pas les seules. À ce titre, le véritable rôle de Marie Dieuleveult auprès du lieutenant de roi De Graffe est d'avoir fait de lui, grâce aux terres acquises aux décès de ses deux précédents maris, un riche et prospère planteur à Saint-Domingue, ce que le Hollandais n'avait jamais été jusques là. Évidemment, c'est beaucoup moins glamour que d'être une piratesse ou une amazone.
La trame des quatre histoires présentées dans L’épopée des femmes pirates — les trois autres étant celles de Mary Read et Anne Bonny, ainsi que de Louise Antonini, qui servit à bord de navires de guerre français sous la République et l'Empire — provient du livre de Marie-Ève Sténuit, Femmes pirates: Les Écumeuses des mers (Paris, Éditions du Trésor, 2015), p. 49-88 (Read et Bonny), 93-106 (Antonini) et 163-171 (Dieuleveult). D'ailleurs, Mme Sténuit, qui est historienne de l'art et archéologue (!), est le principal expert interviewé durant le documentaire. Elle prête bien des intentions à ses héroïnes, et ses propos, ainsi que celle de la narratrice, sont fortement teintés de féminisme, et je n'ai pu m'empêcher de faire un parallèle avec les pires moments des Secrets d'histoire, où l'on voit de l'homosexualité là où il n'y en a pas. Ce n'est plus de l'histoire, mais une sorte de discours politique qui s'alimente à tout ce qui peut le conforter, quitte à perpétuer des faussetés et dire des inepties. Que de talents et d'argent gaspillé. Heureusement, en ce qui concerne ce documentaire, les interventions des historiens Philippe Hrodej, toujours aussi pertinent, et Kevin Porcher, dont j'ai apprécié les textes, et maintenant les commentaires, et de Mme Dominique Rogers, que j'ai découverte à cette occasion, — chapeau bas, madame et messieurs — sauvent un peu la mise, mais à mon avis, pas du naufrage.
Enfin, avis aux producteurs de documentaires traitant de l'histoire maritime, SVP arrêtez de nous montrer des navires à voiles naviguant tout droit sur une mer calme sans aucunes voiles déployées. C'est invraisemblable. On voit bien qu'ils sont propulsés par un moteur! Pitié aussi, moins de reconstitution historique. Si vous voulez faire un film de fiction, faites-en un, mais cessez de mêler les genres, et puis revoir des séquences de combat, qui se ressemblent toutes, aux 10 à 15 minutes, c'est lassant et agaçant, un peu comme la bande-annonce d'un film que l'on visionnerait en boucle.
Cher lecteur, je vous avais prévenu. J'étais d'humeur assassine, et mon sabre, s'il est un peu beaucoup ébréché, peut encore faire mal. Bon, mes excuses à ceux ou celles qu'il aura pu écorcher. Je ne vous connais pas, et il n'y a rien de « personnel » comme on dit ici. C'est juste que vous vous êtes aventurés sur un sujet que je connais très bien, et dont j'ai toujours défendu l'intégrité.



![Infortunios que Alonso Ramírez padeció Carlos de Sigüenza y Góngora (Mexico City, 1645-1700), “Infortunios de Alonso Ramírez. [The Misfortunes of Alonso Ramírez],” Grolier Club Exhibitions, accessed December 1, 2023, https://grolierclub.omeka.net/items/show/1672](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyaEUarIatS-Kr1vbz0be7pk_qFZCIPSsXd_6rXBbiSDgMh6n90hLtB14Au_i7BYp0ZWtG9TcPLNa-7wMtPShGrYYGJBUC4eyXM2a5pVjw3iv2SjQ3boaLSCy-kA5qIjs_XTtO24aaRgE71nNKc_TIHkr3ENBjnWAW7VmQE4dvExzMiUxS9Pb04a2ZG1g/w230-h320/Infortunios%20-%20copyright%20Hispanic%20Societry%20Library.jpg)